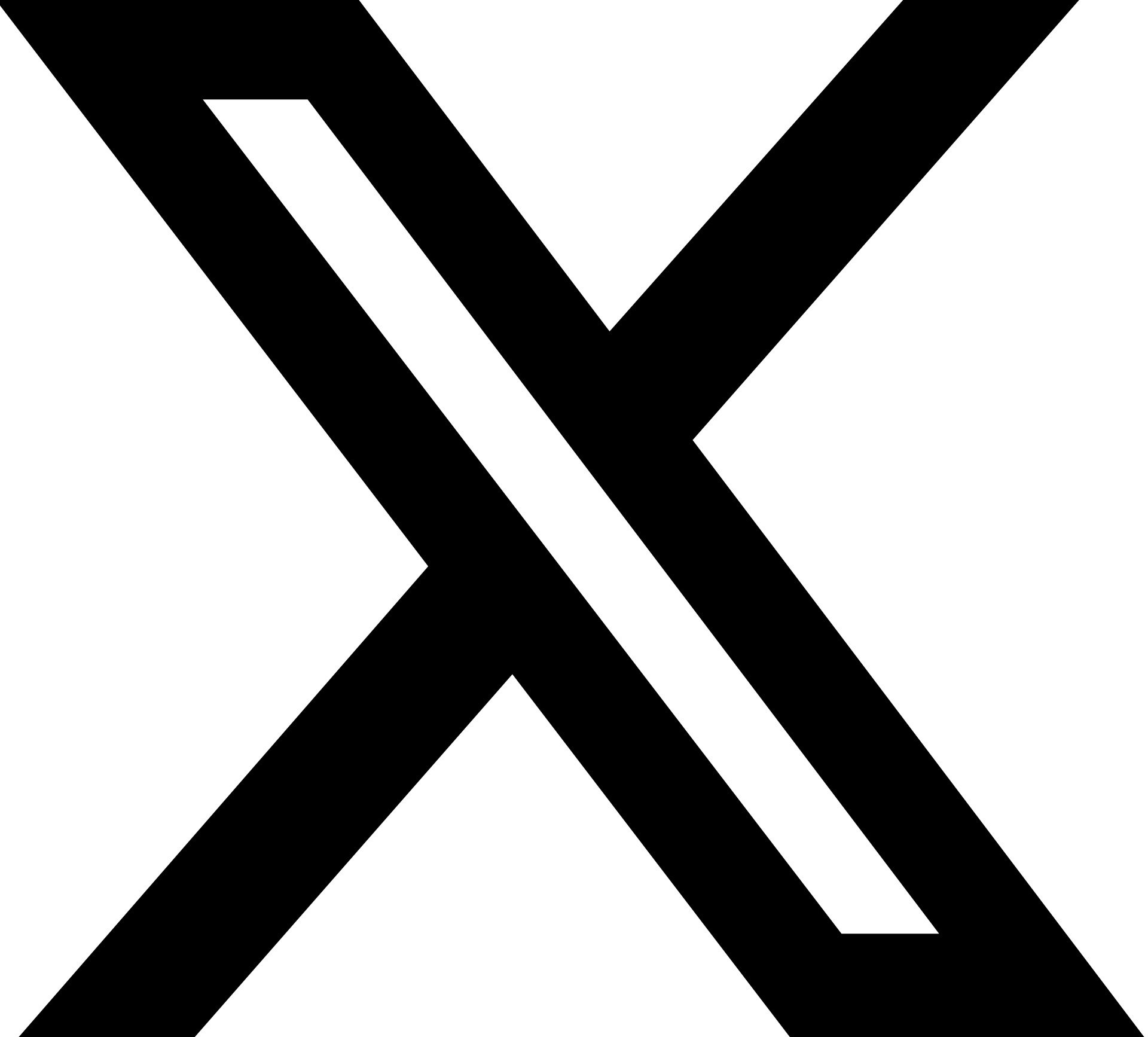Mon étoile jaune (1)
Extraits de l’histoire de Bernard Gurovici, dit Dov Gury.
.jpg)
– « Je suis né à Paris {1930}, à l’hôpital Rothschild, comme la plupart des enfants juifs de ma génération, sous le nom de Bernard Gurovici. Mes parents, Myriam et Simon, venaient d’immigrer en France, de Bessarabie – aujourd’hui rebaptisée ‘‘Moldavie’’.
…
Au début de l’année 1941, nous commençons à sentir que l’étau se referme autour de la population juive, autour de nous. Tous les juifs ont été convoqués dans les commissariats pour y être recensés et que soit tamponnée en rouge la mention « juif » sur les cartes d’identité.
Nous recevons l’ordre de porter notre poste de radio au poste de police le plus proche. Ce qui est fait immédiatement.
Commencent les arrestations, suivant une classification établie à l’avance : d’abord, les juifs communistes et les Allemands anti-nazis réfugiés, fuyant leur régime et arrivés en France récemment ; ensuite, ceux qui n’ont pas de nationalité bien définie, les « apatrides » ; et enfin, les autres – tous les autres…
Je me souviens d’une phrase terrible, entendue à la maison, comme prononcée pour se rassurer : « Ce n’est pas contre nous, c’est contre les Polonais ! ».
Mes parents avaient la nationalité roumaine. C’est de Roumanie qu’ils étaient venus en France.
…
Mes parents reçoivent l’ordre de suspendre au-dessus de leur étalage ; au marché, une pancarte jaune avec une inscription bilingue : « Judischesgescheft » – « magasin juif ».
Ma tante avait une petite boutique de parfumerie au passage ‘‘Prado », sur les Grands Boulevards.
Chez eux, il y a deux pancartes : la jaune, comme chez mes parents, et une rouge. Ils doivent en afficher une autre – une pancarte de couleur rouge et noire, pour annoncer que : ‘‘Ce magasin est en liquidation par le commissariat aux affaires juives. »
Le liquidateur est Monsieur Nicolas, un pur aryen. Bien présent au magasin, il répète à longueur de journée à l’oncle Issar : « Monsieur Merenfeld, vous devez disparaître ! ». En prononçant, cette litanie il a l’air de se délecter. »
.jpg)
Montage photos : Dov Gury. DR.
– « Au printemps 1942, en mai, est décrétée un nouvelle mesure antijuive : « Tout juif ou juive de plus de cinq ans est dans l’obligation de porter d’une manière visible sur l’extérieur gauche de son vêtement une étoile jaune a six branches au milieu de laquelle est écrit en noir : « JUIF ».
Le décret précise la taille exacte de l’étoile et les peines infligées à ceux qui seront pris en défaut de ne pas la porter.
Nous allons chercher nos étoiles au commissariat du 10ème arrondissement. Les étoiles nous sont délivrées gratuitement, mais contre des tickets de textile en vigueur destinés à l’achat des vêtements. Maman me coud l’étoile sur mes vêtements pour aller au lycée. J’y vais avec crainte et appréhension…
Je ne me rappelle plus quelle a été la réaction exacte des professeurs et des élèves quand tous les élèves juifs du lycée Rollin sont arrivés, portant l’étoile. Je ne me souviens que de deux choses :
que j’étais très surpris en voyant combien nous étions nombreux à la porter, et que personne ne nous a molestés, ni même injuriés.
…
En juillet le pressentiment du danger s’accroît au sein de la population juive de Paris.
Ma mère, Myriam, et sa sœur, tante Clara, sont deux femmes seules. Tante Clara est veuve et mon père est loin.
…
Ces deux femmes juives, simples et courageuses, prendront une décision qui ira à l’encontre de ce qu’on appellerait aujourd’hui « Le consensus » établi :
– « Il faut sauver les enfants ».
– « Pour être épargné, il faut aller en zone libre ».
– « Deux enfants seuls n’attirent pas l’attention et ne seront pas reconnus comme juifs’’.
– « Les enfants [Zitta et Bernard] partiront donc seuls’’.
…
Et voilà ce qu’on nous annonce :
« Cette dame est chargée de vous amener par le train à Vierzon. Là, elle vous confiera à une personne qui vous fera franchir la ligne de démarcation. Quand vous serez de l’autre côté, en zone libre, vous reprendrez le train pour Toulouse, où se trouvent nos bons amis, Dora et Joseph Massis. Ce sont eux qui se chargeront de vous indiquer le chemin pour arriver chez tante Fanny. Tante Fanny et oncle Zigmund sont à Grenade sur Garonne. Vous resterez chez eux et y attendrez notre venue, car nous partons après vous. »
…
Le jour de la rafle du Vél d’Hiv’, le 17 juillet 1942, la police française a investi notre immeuble du 34 bis rue de Dunkerque, fouillant tous les appartements occupés par des juifs. Ils sont venus nous chercher dans notre appartement, mais n’y ont trouvé personne – et pour cause : nous étions déjà partis, et les deux soeurs s’étaient réfugiées au sixième.
Apres avoir mis les scellés avec l’inscription : « Bien juif, défense de pénétrer », les policiers sont allés chez la concierge, y laissant un message proclamant que toute la famille Gurovici devait se présenter immédiatement au commissariat le plus proche.
Quatre jours avant cette date fatidique, le 13 juillet, nous nous étions séparés, le coeur très lourd. Ce jour-là, il n’était pas question de se faire accompagner à la gare…
Apres avoir décousu l’étoile de nos vêtements, nous sommes partis de la maison en métro à la gare avec notre convoyeuse. Elle avait des papiers « en règle », résistant à tous contrôles. Dans la gare, il y avait foule : beaucoup de policiers français et allemands, autant de soldats allemands. Nous avons franchi tous les barrages sans encombre, sans être inquiétés.
Montage photos : Dov Gury. DR.
– « Les contrôles étaient très stricts du fait que Vierzon était située sur la ligne de démarcation. D’autant plus que la ville servait de point de passage pour ceux qui voulaient passer en zone libre en fraude…
À la sortie de la gare, nous cherchons, notre accompagnatrice et nous deux, le moyen d’arriver à Châtres sur Cher, le village où nous devions rencontrer notre passeur. Et voilà qu’on nous informe que le car qui doit nous amener à Châtres a été supprimé, que la distance à parcourir est, nous dit-on, de12 kilomètres, et qu’il n’y a en fait aucun moyen d’y arriver ce jour-là, et le lendemain encore moins, car nous étions à la veille du 14 juillet, jour férié!
La personne qui nous accompagnait était une infirme ; elle boitait fortement. Elle nous annonce qu’elle est dans l’impossibilité totale de marcher et nous propose un choix : rentrer à Paris et tenter notre chance une autre fois, ou nous rendre seuls, à pied, à Châtres sur Cher rencontrer le passeur qui nous fera passer la ligne de démarcation moyennant la somme d’argent prévue à cet effet, et que nous devions lui remettre au préalable, avant l’opération.
…
Je ne sais plus comment nous l’avons trouvé, mais nous avons réussi. J’ai appris par la suite que tout le village savait qu’il faisait le travail de passeur…
Mais une grosse surprise nous attendait… : pourquoi, lui qui faisait le métier de passeur, a-t-il refusé… de nous faire passer ? Peut-être croyait-il à une provocation, ou à un piège pour le dénoncer ?
…
Nous quittons cet homme et louons pour la nuit une chambre dans l’hôtel situé au centre du village, entre la Poste et l’église. Personne ne s’étonne du fait que deux enfants louent une chambre d’hôtel ! À croire qu’ils savaient exactement dans quel but nous sommes là…
Zitta reste dans la chambre pour soigner ses pieds en sang, et moi, je descends voir ce qu’on peut faire.
Au comptoir de l’hôtel, je commande à la parisienne « un Diabolo Grenadine ». Le café est vide, et la serveuse, guère plus âgée que moi, est sympathique et me paraît digne de confiance. De la manière la plus naïve et la plus directe, je lui pose la question :
– « Dites, mademoiselle : est-ce que vous avez un tuyau à nous conseiller pour passer de l’autre côté? »
– « Rien de plus simple ! À six heures du soir exactement, les Allemands postés sur le pont finissent leur tour de garde et quittent leur guérite. Pendant assez longtemps, il n’y a pas de gardiens sur le pont, jusqu’à l’arrivée de la garde de nuit. Vous avez assez de temps pour passer quand il n’y a personne. IL suffit que vous soyez aux alentours du pont. Guettez la patrouille. Quand ils entrent dans le café au bout de la rue, vous allez au pont, vous écartez les barbelés, et vous passez! De l’autre côté, en zone libre, il n’y a personne… Il est bientôt six heures : dépêchez vous si vous voulez le faire aujourd’hui ! »
Photo : Dov Gury. DR.
– « À six heures exactement, les soldats quittent le pont. Nous les suivons des yeux et les voyons disparaître dans leur hôtel, à cinq cents mètres du point de contrôle. Nous allons droit au pont. Une dame qui se trouve là nous interpelle : « Où allez-vous, les enfants? Vous ne voyez pas que les Allemands sont partis! ».
Nous avançons sans nous arrêter. Au pont, sans difficulté, nous écartons les chevaux de frise qui bouchent le passage. C’est fermé, mais de façon à ce qu’on puisse ouvrir facilement afin de permettre aux riverains de franchir cette frontière artificielle en fonction des besoins agricoles.
À cet endroit, le Cher est assez large. Le pont métallique, toujours là, est long de plus de trois cents mètres.
Nous commençons à courir. Zitta, la plus grande, court devant moi. Au milieu du pont, je ressens un »point de côté » qui m’empêche de courir. La force me manque et je m’arrête. Paralysé par la peur, j’appelle Zitta en pleurant : « Aide-moi, je n’en peux plus! ». Elle s’arrête, revient, m’attrape par la main et me tire de force jusqu’au bout du pont.
De l’autre cote, il n’y a personne. Nous nous reposons et voyons la garde de nuit allemande marcher doucement vers leur poste.
« Nous avons réussi : nous sommes en zone libre!!!
…
Nous entrons dans une ferme. Nous leur demandons comment continuer notre chemin pour prendre le train de Toulouse. Ils nous expliquent qu’il n’y a pas de communication, ni ce jour-là, ni le lendemain, 14 juillet. Rien ! En échange de l’hospitalité, ils nous proposent de ramasser des pommes de terre avec eux, le lendemain. « Après-demain, vous pourrez prendre le car pour la gare », nous disent-ils.
…
Vers dix heures du soir, quelques minutes avant l’obscurité, nous débarquons par surprise chez Oncle et Tante, lesquels, eux non plus, ne savaient rien de notre venue.
Nous leur racontons nombre de fois ce qui nous est arrivé sur notre chemin depuis que nous sommes partis de Paris. Comment nous nous sommes sépares de nos mamans.
Nous avons aimé tout de suite notre séjour à Grenade. Après les privations, la vie à la campagne, surtout les magnifiques pêches que Tante Fanny recevait par cageots après son travail au calibrage des fruits.
À la fin du mois de juillet, la famille était de nouveau réunie. Papa est arrivé en train du Massif central, tandis que Maman et tante Clara traversaient la ligne de démarcation… dans une voiture de l’armée allemande !
Car il existait un trafic clandestin organisé par les soldats allemands, lesquels faisaient passer la Ligne aux juifs dans leurs propres véhicules. Ils se faisaient payer au prix fort : l’argent des juifs ne leur répugnait pas… »